Excès de confiance et aveuglement cathodique
![]()
CARTES ÉLECTRONIQUES ET LECTEURS DE CARTES
Pour la France et sur ses zones d’outremer, le SHOM gère, la cartographie maritime et la bathymétrie en exclusivité . Il édite des cartes, des mises à jour et des documents de navigation. Les cartes peuvent être éditées en présentation papier ou numérique. Le SHOM peut accorder un droit de publication digitalisé à des organismes accrédités qu’ils soient nationaux ou étrangers. Le cas le plus connu étant Maxsea et ses cartes rasters ‘’Mapmedia’’. Lisibles à partir d’’un PC, on les trouve généralement installées sur la table à carte, ou un écran dédié près de l’appareil à gouverner. D’autres éditeurs, et/ou fabricant de matériel utiliseront également cette cartographie numérique. Parmi les plus connus : Raymarine, Garmin, Furuno, etc… Enfin, dernièrement, surfant sur le succès marketing des Smartphones et tablettes, Navionics propose une cartographie d’entrée de gamme pouvant présenter un intérêt pour les promenades côtières à la journée.
Si les éditions papier offrent la garantie de la précision et des mises à jour régulières, les éditions numériques peuvent poser problème si les règles d’échelle ne sont pas respectées. Les risques seront limités avec une digitalisation scannée (raster), les cartes devenant rapidement illisibles. Il en va autrement avec les cartes vectorisées, où la pixellisation des caractères permettra un grossissement lisible par zoom, sans pour autant améliorer la qualité du détail (c’est un bête grossissement par effet de loupe)
Cette multiplication d’écrans présente l’avantage de sa modularité, et permet des traitements multitâches. Extrêmement pratiques ils peuvent, cependant, créer un effet hypnotique perturbateur et dangereux. Le confort offert peut alors devenir un piège en faisant oublier la règle essentielle du contrôle de sa route : mettre le nez dehors et critiquer son point.
Exemples types, d’écrans et du potentiel informatif, de programmes de navigation.
Les ECDIS [1]
|
 |
![]()
Pour les petits navires de plaisance des logiciels permettent de visualiser les ENC. [2] Ainsi avec un coût abordable il est possible de naviguer avec des cartes marines électroniques officielles. Comme les logiciels destinés aux professionnels, ces logiciels, même ceux de base, possèdent de nombreuses fonctionnalités (report de la position GPS, calcul et suivi de route, déplacements, etc.). Ils permettent le plus souvent de visualiser les ENC avec les mêmes couleurs et symboles que pour les ECDIS des navigateurs professionnels. Attention cependant : tous ces logiciels visualisant des ENC ne sont pas capables de visualiser des ENC cryptées.
![]()
Les ECS [3]
ECS basiques
ECS polyvalents
Tablettes, Smartphones
Portés par le succès des cartes vectorielles d’entrée de gamme, ces petits lecteurs de carte envahissent le marché.
|
 |
![]()
CARTOGRAPHIE ELECTRONIQUE - LES RISQUES D’UTILISATION
Les risques matériels
- Panne système du lecteur : erreur ou panne GPS, panne totale ou partielle du système, rupture d’alimentation, défaillance des accumulateurs, etc… Les solutions pourront être préventives, soit en doublant le matériel, soit en prévoyant une cartographie papier à jour. Une solution élégante peut être de doubler l’utilisation d’une ECS par une tablette ou un Smartphone, équipés d’un GPS, utilisant une cartographie d’entrée de gamme type Navionics. Branché par un câble USB à l’ordinateur principal, qu’il pourra suppléer instantanément en cas de panne avec une autonomie limitée mais suffisante sur l’instant
![]()
Les risques logiciels
- Hors de portée financière, la plus part du temps, les ECDIS ne sont pas facilement utilisable sur de petits voiliers. Les ECS utilisent une cartographie quelquefois discutable hors zones de routes commerciales
- Exemple de cartes Navionics en Grèce : erreurs sur Chios
- Exemple de cartes Navionics en Turquie : erreurs sur Bozburun
- Exemple de cartes Navnet et C-map : erreurs sur Kastellorizo
Navionics est généralement réactif, et corrige les erreurs qui lui sont signalées
- Les erreurs de compensation géodésiques : les fichiers de cartes reprenant des assemblages d’origines diverses, dont les coordonnées géodésiques varient d’une échelle à l’autre, elles peuvent exiger des systèmes de compensations complexes et difficiles à mettre en oeuvre
- Exemple de système de compensation : compensation géodésique des CM93
- Des erreurs de trait de côte, les plus fréquentes en particulier sur les zones peu fréquentées, où certains relevés peuvent dater du 18ème siècle.
- La solution dans ce cas sera de contrôler le trait de côte avec une fusion/transparence reprenant des photographies aériennes parfaitement géolocalisées : Google Earth est parfait pour cela. Voir le programme GE2KAP
Les risques comportementaux
Les plus insidieux, les plus dangereux, Il y a un véritable risque d’addiction à l’écran.
- C’est vrai pour les enfants, voir : quelle attitude par rapport aux tablettes
- C’est vrai pour les adultes, la mémoire de diminue pas, elle change d’objet, voir : les écrans rendent-ils idiots ???
![]()
Tous les skippers, tous les navigateurs, tous les capitaines de navires ne sont pas des enfants ou des idiots. Mais le risque est grand d’un abaissement de la vigilance, conforté par l’apparente fiabilité des informations à l’écran. Et c’est arrivé à de grands professionnels tous récemment :
![]()
Excès de confiance et aveuglement cathodique
1er exemple : le 29 novembre 2014 Team Vestas s’échoue sur Cargados Carajos Shoals
|
 |
 |
![]()
Excès de confiance, ou aveuglement cathodique ???
Probablement les deux
- Excès de confiance, si l’on en croit Marcel Van Triest [4] , navigateur, routeur et météorologue, la détermination de la route appartient à chaque étape à Wouter Verbraak, le navigateur de Team Vestas... Mais il craint le pire : « Si c’est une erreur de Verbraak, il le portera avec lui pour le reste de sa vie ». Ce qui ne dédouane pas pour autant le skipper, car on peut imaginer que si Wouter Verbraak s’est laissé abuser par l’aveuglement cathodique, le skipper qui se savait en zone inconnue a fait preuve d’un excès de confiance fatidique.
- Ce que dit Verbraak : Nous n’avons pas vu le récif sur les cartes électroniques. J’avais vérifié la zone sur la carte électronique avant de me mettre au repos après une très longue journée d’étude sur la tempête tropicale qui nous menaçait, et j’avais vu indiqué des profondeurs de 42 et 80m.
- Je peux assurer que nous regardons avec diligence notre route, et que nous utilisons les cartes aériennes Google Earth, des cartes papier et d’autres outils. Cependant, notre itinéraire prévu a changé juste avant notre départ, j’ai à tort pensé que j’aurais assez d’informations pour anticiper les changements dans notre itinéraire. J’ai eu tort. Je n’essaie pas de faire des excuses, j’essaie juste d’offrir une explication pour répondre à vos questions. voir le lien : Les explications de Verbraak
![]()
- aveuglement cathodique si l’on en croit Yann Riou, journaliste sur Dongfeng Race Team, citant Charles Caudrelier, le Skipper qui avait remarqué cet archipel quelques jours plus tôt, et notant qu’il est en fait assez difficile à trouver. Pour le voir sur nos cartes électroniques, vous devez effectuer un zoom en plein sur le dessus de celui-ci. Mais comment et pourquoi voudriez-vous zoomer dessus si vous ne savez pas qu’il est là en premier lieu ? Ainsi, alors que nous ne savons pas exactement ce qui s’est passé sur Vestas, nous pouvons imaginer comment c’est arrivé. Voir ce lien : Source Géogagrage
- Sur ce sujet, voir l’excellent fil de H&O inité par Pytheas54 : l’échouement du Vestas
![]()
2ème exemple : Le 04/11/2012, à 08H56, le MARION DUFRESNE II talonne sur des brisants connus à l’ouest de l’île de la possession
Ce talonnage à fait l’objet d’une enquête du BeaMer : Talonnage du navire océanographique Marion Dufresne II
- Le navire est récent
- Le navire est bien entretenu
- L’équipage est qualifié, connait le bateau et la région
- Pourtant, par beau temps et belle mer, il talonne sur des brisants qui se trouvent à 2 M au SW du cap de l’Héroïne
- Ces brisant bien que mal décris, sont connus :
- Les Instructions Nautiques édition 2001 : des brisants se trouvent à 2 M au SW du cap de l’Héroïne, marquent probablement des roches dangereuses…
- Même assorti d’une réserve, ces brisants reconnus depuis, doivent nécessairement attirer l’attention du commandement du navire sur la nécessité pour la route tracée de prendre en compte les incertitudes de positionnement des roches dangereuses et pour l’officier de quart de suivre la route tracée.
- Ce qui a été fait pour la route tracée (en jaune) où le point tournant (WP28) laisse de l’eau à l’ouest des brisants.
- Le matériel de navigation
- Pour les 7 GPS du bord, l’ellipsoïde de référence est toujours le WGS 84
- Une table traçante « Nautoplot », et une carte papier SHOM 6497 a été positionnée et corrigée correctement pour que son système géodésique ancien le système géodésique IGN 62, corresponde aux coordonnées géodésiques du GPS. Il s’agit d’une carte au 1:75 000. Seule l’arrivée sur la baie du Marin à l’Est de l’île offre une précision de détail suffisante, au 1:10 000.
- Un ECS (système de navigation TRANSAS) dont l’indicateur est placé à droite de la table traçante, est connecté au compas gyroscopique actif, au loch doppler et au GPS. Sur une affichette apposée à gauche du clavier de contrôle, il est précisé que l’ECS n’est pas un moyen approuvé de navigation. La carte « ARCS » (Admiralty Raster Chart Service), reprend les informations de la carte SHOM 6497, avec une erreur : la ligne de sonde des 100 m est fiabilisée en trait plein alors que celle du SHOM en pointillé indique une incertitude sur son tracé. Il n’existe à ce jour aucune ENC ou RNC à moyenne ou grande échelle couvrant l’archipel de Crozet.
- En résumé sur le matériel de navigation, le navigateur avait le choix entre une carte papier à la géodésie corrigée pour les WGS84 des GPS, et un lecteur de cartes ECS utilisant une carte dont la géodésie n’était pas corrigée avec une erreur de 443 m dans le 49°. D’un côté une machine lourde et difficile à gérer, mais précise, de l’autre, un écran d’ordinateur « zoomable », pratique et multitâches, mais avec une cartographie douteuse.
Or, contre toute attente :
- En noire la trace théorique sur l’ECS
- En rouge la trace réelle, ramenée en WGS84
- En jaune la route prévue et le point tournant 28
- On se rend bien compte de l’écart entre la trace théorique, basée sur une géodésie différente et celle réelle reconstituée sur la géodésie vraie des GPS : WGS84.
- On se rend aussi parfaitement compte du risque pris en coupant à l’intérieur du WP28. Quelle que soit l’option de trace, on est immédiatement sur les cailloux
![]()
Excès de confiance, ou aveuglement cathodique ???
Probablement les deux
- Excès de confiance
Pour le commandant, probablement, la mer est belle, il est déjà passé plusieurs fois à cet endroit- à 08H16, il commande la manœuvre de dérapage de l’ancre au mouillage de Pointe Basse
- à 08H44, une fois paré le cap de l’héroïne, près avoir paré Roche Percée (d’assez près, et largement à l’intérieur du point tournant WP 27), le navire passe à 0,55 mille dans l’ouest de la Pointe des Moines (point radar). Le commandant transfère la responsabilité du quart au lieutenant qui l’accepte, il attire son attention sur les brisants et se rend sur l’aileron bâbord.
- Le navire fait route à 11 nœuds au cap 212°. La route tracée est au 208°, le relevé radar ayant donné une position à « l’intérieur » de la route tracée, le cap est donné afin de revenir sur la route initiale (au 208°).
- Or, la mer est belle, les roches affleurants ne brisent pas, et elles sont invisibles. C’est peut-être la raison du déplacement du commandant sur l’aileron bâbord
- Or, le lieutenant de quart effectue son second quart à la passerelle depuis l’appareillage de La Réunion, et c’est son premier embarquement sur le Marion Dufresne II.
- à 08H52, le lieutenant fait un point radar qu’il porte sur la carte. La position relevée indique que le navire est à 0,2 mille à l’intérieur de la route tracée et à 1 mille du WP « point tournant » n° 28 (à l’ouest des brisants) indiquant le prochain changement de route
- à 08h53, le lieutenant ordonne au timonier : « 10 à gauche ». Comme le navire vient rapidement sur bâbord, le lieutenant ordonne : « Comme ça » (c’est-à-dire de gouverner au cap suivi par le navire au moment où l’ordre est donné). Le timonier « rencontre » rapidement afin de rester au cap qui est alors au 180°.
- à 08h55, estimant être par le travers des brisants, le lieutenant aurait ordonné (il ne se souvient pas d’avoir donné cet ordre) au timonier de prendre le cap 125°. Le timonier vient doucement sur la gauche.
- Voyant le navire en giration et comprenant que le changement de route est prématuré, le commandant revient au centre de la passerelle. Il s’aperçoit que le navire est nettement à l’intérieur de la route tracée.
- à 08h56, le commandant ordonne alors au timonier de mettre la barre à zéro, celui-ci s’exécute. Quelques secondes après, il ordonne de mettre la barre toute à droite et au même instant un choc important est ressenti sur l’avant. Le navire part violemment à la gite sur tribord. La vitesse passe de 11 à 6 nœuds. Le commandant réduit l’allure à « Avant Lente ».
- Trop tard, le navire à talonné dans ses conclusion, le BeaMer indique que par sa dernière manœuvre, le commandant a sauvé le navire : “Les changements de route anticipés par rapport à la route tracée, suivie approximativement, constituent un facteur aggravant des facteurs précédemment qualifiés. Cependant, le fait que le commandant ait arrêté la giration, lorsqu’il s’est rendu compte de la manœuvre engagée, a sauvé le navire.”
- aveuglement cathodique
Concernant le lieutenant de quart, c’est net et souligné clairement dans le rapport du BeaMer :
Il y a bien un aveuglement cathodique, à la décharge du lieutenant, et ce n’est pas souligné dans le rapport du BeaMer, mais l’utilisation et la lecture d’une carte papier au 1:75 000, est particulièrement délicate. le réglage de ces tables traçantes exigeant aucun pli et un positionnement parfait de la carte, aggravant la difficulté d’interprétation sur les grandes échelles. La tentation, alors, est forte de se fier à l’écran zoomable de l’ECS
![]()
3ème exemple : le 30 mai 2014 patrouilleur de la douane ARAFENUA s’échoue sur atoll de Tikei (archipel des Tuamotu)
- Lors d’une mission de surveillance, le patrouilleur de la douane ARAFENUA après avoir appareillé le 30 mai 2014 à 22h00 de l’île de Fatu Hiva (archipel des Marquises) à destination de l’atoll de Tikei (archipel des Tuamotu) s’y est échoué le 1er juin vers 04h00.
|
 |
 |
![]()
Description du navire
Vedette de type unique construite en CVR au chantier Couach à Arcachon et lancée le 25 septembre 1992. Elle a rejoint peu après Tahiti où elle est depuis affectée à la brigade de surveillance maritime de la douane.
- Principales caractéristiques du navire :
- Longueur hors-tout : 32,28 m
- Largeur : 6,48 m
- Jauge : 149 tx
- Franc-bord : 1936 mm
- Motorisation : 2 diesel Detroit-GM 16V92 – 1620 kW - 2 hélices
- Équipement électronique :
- 1 ordinateur de bord (avec logiciel de navigation « MaxSea » couplé à un GPS et un radar). Cette installation date de 2012
- 2 GPS
- 2 radars Furuno dont le plus récent est couplé avec le logiciel MaxSea dont il partage l’écran (overlay, fenêtres séparées ou affichage unique), le radar le plus ancien possède son propre écran plein jour
- 1 sondeur
- Cartographie
- Le patrouilleur dispose d’un équipement de cartographie électronique qui fonctionne avec le logiciel MaxSea. Cet équipement est un ECS et non pas un ECDIS. Ce n’est pas une ENC publiée par un service hydrographique officiel. En conséquence, l’équipement de cartographie électronique ne peut constituer qu’une aide à la navigation, il ne peut pas être le système primaire de navigation ou de référence.
- Il n’existe pas de carte d’atterrissage de l’île. La carte papier la plus précise est la « 6689 – Iles Tuamotu (partie ouest) », celle utilisée pour l’approche. Elle est, vue l’échelle (1/595 000), inexploitable pour une navigation à proximité directe de Tikei. Elle a été établie d’après les renseignements bathymétriques recueillis par le SHOM jusqu’en 1977. Sa dernière mise à jour date de 2010. La référence géodésique n’apparaît pas sur cette carte. Sur une telle carte 1mm fait 595 m, l’épaisseur du trait de crayon (0,3 mm) représente 178,5 m. Un cartouche indique que la carte ne doit pas être utilisée sans consulter d’autres documents, en particulier le volume 1 du guide du navigateur pour les informations concernant les cartes marines, leur précision et leur limitation.
Circonstances de l’accident
L’échouement a lieu le dimanche 1er juin peu avant 04h00 par 14°56’,504 S et 144°32’,436 W sur la côte nord de Tikei. Il fait nuit noire et il pleut (voir bulletin de Météo France en annexe). [5]
- Tikei est une petite ile corallienne longue de 2 milles, boisée, sans lagon, inhabitée et non balisée, du nord des Tuamotu en Polynésie Française. Elle est distante de 345 milles du port de Papeete à Tahiti. Il est difficile d’y débarquer car l’île est entourée de toutes parts d’un récif qui se compose d’une première barrière à fleur d’eau puis d’un platier couvert de 20 cm d’eau. Le marnage y est très faible, environ 30 cm. La ligne de sonde des 1000 mètres est située à environ 0,6 mille du récif.
- Avant d’appareiller de Fatu Hiva le vendredi 30 mai, le capitaine à la mer réunit une partie de l’équipage pour exposer la mission.
- A l’issue, il trace la route sur le PC MaxSea. Partant de l’extérieur de la baie des vierges de Fatu Hiva, la route tangente la ligne de sonde des 1000 mètres dans le nord-ouest de Tikei.
- Il demande au chef de quart A de reporter cette route sur les cartes papier. La route passe à 1 mm de l’îlot de Tikéi sur la carte 6689 (soit moins de 600 m) et le point d’atterrissage n’est pas formalisé alors que c’est la première fois que l’Arafenua s’approche de Tikéi. Il apparait que les règles de prudence n’ont pas été respectées. En particulier le principal conseil pour le tracé d’une route de façon à parer les dangers qui est la « règle du pouce ».
![]()
| Projet de route sur une carte fausse | Atterrissage brutal sur une carte juste |
|---|---|
 |
 |
![]()
Ainsi
La force de l’habitude et l’absence de doute constructif dans l’exploitation des aides à la navigation conjugués à un manque de vigilance dans l’élaboration et le suivi de la navigation ont conduit à l’échouement.
Les recommandations du BeaMer
![]()
NDLR : il y a toujours un risque de voyeurisme lorsque l’on traite d’accidents. Les trois exemples sont spécifiquement traités, parce qu’ils concernent des professionnels, preuve que ces problèmes d’attention et d’addiction aux écrans peuvent arriver aux meilleurs. C’est dans ce cadre qu’il convient de considérer ce dossier
Michel, s/y Laorana janvier 2015


 Suivi RSS
Suivi RSS Conception
Conception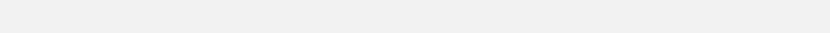


 Version imprimable
Version imprimable Publié Janvier 2015, (màj Janvier 2015) par :
Publié Janvier 2015, (màj Janvier 2015) par :














