La nouvelle norme :
La nouvelle Division 240 a introduit d’importantes différences avec l’ancienne réglementation :
Au-delà de 6 milles d’un abri, l’emport d’un radeau est obligatoire, mais :
- Le type est laissé à l’appréciation du chef de bord en fonction de la navigation pratiquée
- La taille doit être adaptée au nombre de personnes réellement embarquées et n’est plus liée à la capacité d’emport théorique du bateau.
Le radeau doit être conforme à la norme ISO 9650, une homologation nationale apportant une sécurité supplémentaire quant à l’assurance de cette conformité.
Deux types de radeaux :
La norme ISO 9650 définit deux types de radeaux : hauturier (ISO 9650-1) et côtier (ISO 9650-2).
Les radeaux hauturiers sont répartis en deux catégories : groupe A (-15 à +65° C) et groupe B (0 à 65 ° C). Le groupe peut être choisi en fonction de la zone de navigation et de la saison. Un radeau groupe B peut être en théorie un peu plus léger et moins cher qu’un groupe A, mais la différence est faible et la plupart des constructeurs ne proposent que des groupe A.
Les radeaux côtiers sont une version simplifiée des radeaux hauturiers, prévus pour une navigation près des côtes par beau temps. On suppose que les secours pourront intervenir très rapidement.
Différences principales :
| |
| |
 |
 | |
| Surface de plancher par occupant | |
|
| Tente de protection | |
|
| Fond isolant thermique | |
|
| Récupérateur d’eau de pluie sur la tente | |
|
Il apparait donc que les conditions de vie à bord d’un radeau côtier seront plus difficiles si le séjour dépasse quelques heures, d’autant que la norme n’est guère généreuse sur le gabarit des occupants (passager de 75 kg et 47 cm de largeur aux épaules).
L’armement obligatoire :
Une nouveauté importante de la norme est que l’armement obligatoire inclus dans le radeau est minimal. C’est d’ailleurs le même pour les radeaux côtiers et hauturiers « - de 24 heures », à part 0,5 litre d’eau par personne en plus pour le radeau hauturier.

A savoir : une ancre flottante, un halin de secours à lancer, un couteau, une écope, un gonfleur, un kit de réparation, une paire de pagaies, deux éponges, deux feux parachute, trois feux à main, une lampe torche à piles, un miroir de signalisation, un sifflet, des comprimés contre le mal de mer et un sac à vomi par personne.
Certains constructeurs sont un peu plus généreux que la norme : par exemple Zodiac/Bombard prévoient une seconde lampe sur les radeaux hauturiers – de 24 h (photo ci-contre).
![]()
![]()
Pour une utilisation vraiment hauturière, la norme ISO prévoit un armement complémentaire en « grab-bag » séparé dont une liste minimale est donnée. En pratique, le contenu de ce conditionnement séparé peut être tout à fait légalement défini par le chef de bord et maintenu sous sa responsabilité, hors du circuit des visites de contrôle périodiques, ce qui apporte souplesse et économie.
Crédit photos : Zodiac
Autoredressable ou non ?
Le concept de radeau autoredressable est ancien, mais a été remis au goût du jour récemment par certains constructeurs, pour des raisons surtout marketing, semble-t-il.
Comment ça marche ?
Le principe est tout simple : des arceaux surdimensionnés maintiennent le radeau, s’il se gonfle à l’envers, en position « sur la tranche » et le poids de la bouteille de gaz de gonflage assure le redressement, comme pour un dériveur. En eau calme et sans vent, ça fonctionne fort bien. Ceci est vendu comme un remède à la crainte du plaisancier de voir, le jour venu, son radeau se gonfler à l’envers, occurrence assez fréquente dans mon expérience. Ce n’est cependant pas la panacée souvent présentée…
| |
|
 |
 |
L’opinion des spécialistes est en effet plus nuancée, car cette solution apporte aussi ses inconvénients, en particulier une silhouette de la tente beaucoup plus haute (voir photos), augmentant beaucoup (x 2 ou 3) le fardage, ce qui peut avoir des effets négatifs sur la stabilité par très mauvais temps et rendre le halage sur le bout fixé au radeau pour le ramener auprès du bord après gonflage très difficile, voire impossible. Par ailleurs, le système n’est d’aucune utilité pour redresser un radeau qui serait chaviré par une lame avec ses occupants.
Conclusion : le choix autoredressable ou non est votre, en se rappelant que redresser un radeau chaviré n’est pas difficile dans les petites tailles et qu’il vaut peut-être mieux placer la différence de coût en stage de survie…
Crédit photos : Sea-Safe
Quel modèle choisir ?
En fonction des renseignements ci-dessus et des conditions de navigation envisagées, il appartient au chef de bord de faire son choix.
Deux points doivent être considérés en particulier à mon avis :
- La taille définie par la norme est vraiment minimale et il peut être intéressant de prendre une taille supérieure au minimum de la norme, notamment en cas de navigation hivernale (vêtements chauds ou combinaisons d’immersion), d’autant que la différence de prix et d’encombrement peut être minime. Ne pas exagérer cependant, un radeau peu chargé peut poser des problèmes de stabilité par grosse mer.
- L’hypothermie est le plus grave danger pour les survivants qui ne peuvent guère bouger et trempent plus ou moins dans l’eau. Un fond isolé est un plus important à ce point de vue dès que la température de l’eau baisse. Ce fond, suivant les constructeurs, peut être isolé par de la mousse aluminisée ou à double paroi gonflable, de préférence « matelassé » (gonflage à faire manuellement après embarquement par les passagers, assez délicat). L’efficacité est similaire, mais la solution mousse plus simple à l’usage.
- Un autre point de choix est le conditionnement : conteneur rigide ou valise ?
Il faudra faire le choix en tenant compte des impératifs de mise à l’eau rapide et des possibilités de stockage à bord. Un radeau en valise doit rester accessible et ne doit pas supporter de charges lourdes.
Se rappeler qu’un stockage à l’abri et en conditions fraiches et sèches, surtout hors saison, améliore le vieillissement du radeau.


 Suivi RSS
Suivi RSS Conception
Conception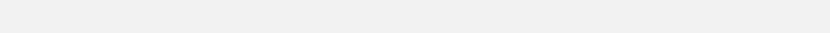


 Version imprimable
Version imprimable Publié Janvier 2012, (màj Mars 2012) par :
Publié Janvier 2012, (màj Mars 2012) par :





